Culturel
" Une vie, une Oeuvre, pour le plaisir
des passionnés d'Art Alsacien "
francois.walgenwitz@sfr.fr
Roger Mühl
La modernité sereine
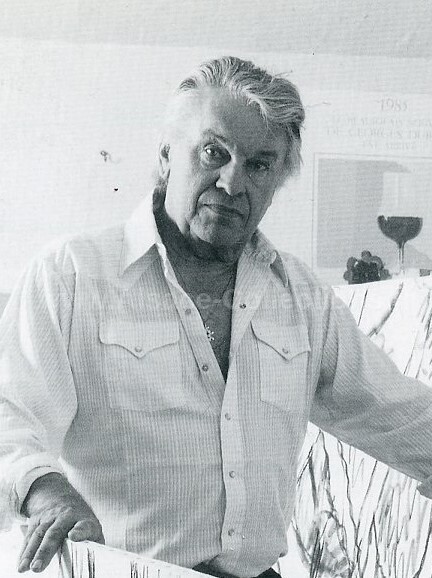 © Collection particulière © Collection particulièreRoger Mühl Roger
Mühl a su mettre du talent dans son œuvre; un talent
qui s’est imposé
irrésistiblement à deux moments-clés
de l’existence: sa scolarité et le
lancement de sa carrière. Il a mis du génie dans
sa vie en créant dans
l’enthousiasme, sans lequel on ne fait rien de grand. Roger
Mühl est né le 20 décembre 1929
à Strasbourg dans une
famille de graveurs. «Au
XVIIIème siècle,
nous étions déjà des artistes»,
aimait-il à préciser. Il a passé son
enfance dans le petit village de Krautwiller, à 18 km de sa
ville natale. Il
grandit en liberté dans ce hameau paisible, niché
au milieu d’une campagne dont
il découvre et apprécie tous les secrets. Ce qui
explique le besoin qu’il
éprouvera de «vivre au
contact de la
flore et de la faune agreste, une faim jamais assouvie
d’horizons dégagés»
(1)
Seules l’influence de sa famille et celle de ses petits
camarades le
marqueront. A l’école communale de Krautwiller, il
est l’élève de son père,
instituteur.  Collection
particulière Collection
particulièreChemin
de Krautwiller Huile
sur toile, 46 x 38 cm (1950-60) A
l’âge de dix ans, il entre au lycée
Kléber de Strasbourg,
où il se rend chaque jour en passant par Brumath. Son
attirance pour la nature
s’épanouit dans sa vocation précoce
pour le dessin et la peinture. Ses loisirs
se partagent entre les croquis, les esquisses aquarellées;
il s’applique à des
portraits; il se plaît aux travaux des champs à la
ferme de son oncle, gardant
les bêtes au pâturage, participant aux moissons.
«La moisson… Que de fois, se souvenant de son
enfance, ne l’a-t-il pas traitée
dans ses gouaches ou huiles, transfigurée par sa vision
particulière en volumes
enrobés d’une poussière d’or,
aux chromes vibrants d’une intensité majeure,
à
l’apogée du pur éclat, y faisant passer
en une magistrale synthèse tous les
frémissements de la nature.» (1)  Collection
particulière Collection
particulièreMoissons
en Alsace Huile
sur toile, 100 x 50 cm (1961-70)
Les années sombres de la
Deuxième Guerre Mondiale le
marqueront comme elles ont marqué tous les jeunes de sa
génération.
L’adolescent, qui a 16 ans à la
Libération, entre en classe de Seconde. Privé
pendant quatre ans de la pratique de sa langue maternelle, il se trouve
handicapé comme la plupart des jeunes Alsaciens. Or, il
s’agit de passer le
bac; ce qui ne s’avère pas évident.
De fait, il consacre à la peinture la
majeure partie de son
temps libre. «Il s’y
adonne avec d’autant
plus de fougue qu’il a secrètement conscience de
l’épanouissement
graduel de son talent.» (1)
Il
acquiert la technique et, pour le moment, s’applique
à reproduire fidèlement,
scrupuleusement, les images que la vie lui transmet. Cependant, pointe
déjà
l’affirmation de sa personnalité.
Un incident heureux va mettre un terme à
l’inquiétude que
lui cause l’obtention du bac. Son professeur venait
d’acheter chez un marchand
strasbourgeois de couleurs, à l’enseigne de
«La Palette d’Or», deux tableaux
signés Mühl… «Intrigué
par la similitude
des noms, il demanda un jour à son
élève s’il ne se trouvait pas, dans sa
famille, un peintre de ce nom. Quelle ne fut pas sa surprise
d’apprendre que
Roger en était l’auteur; il lui conseille
sans détours, vu l’impossibilité
qu’il aurait de rattraper son retard en
français, de se vouer entièrement aux
arts.» (1)
C’est ainsi, qu’à
l’initiative d’un pédagogue clairvoyant,
Mühl s’inscrit à l’Ecole des
Arts Décoratifs de Strasbourg. Il y reste trois
ans, de 1947 à 1949. Elle est, alors, sous la direction de
Louis-Philippe Kamm.
Il est l’élève de Gustave Lehmann,
aquarelliste, décorateur d’églises,
notamment… Il conservera de son maître un souvenir
inaltérable de
reconnaissance.
A l’EADS, il se lie
d’amitié avec un étudiant
nommé
Jean-Pierre Haeberlin dont il ornera plus tard le restaurant de ses
plus
grandes toiles. Aujourd’hui, grâce à
cette amitié, l’Auberge de l’Ill
à
Illhaeusern est devenue l’un des plus beaux
restaurants-galerie du monde  Collection
particulière Collection
particulièreJean-Pierre,
Marc et Paul HAEBERLIN  Collection
particulière Collection
particulièrePaysage
de Provence Huile
sur toile ornant l’Auberge de l’Ill
Jean-Pierre qui nous offre son aimable
témoignage: «C’est
en 1947, à l’école des arts
décoratifs de Strasbourg que j’ai fait la
connaissance du benjamin de la
Section Peinture: Roger Mühl. Notre camaraderie
d’abord, s’est vite transformée
en une profonde amitié qui n’a
cessé
de se confirmer au fil des années.» (2)
En 1948, Roger Mühl entre dans la revue
«Barabli» de
Germain Muller comme décorateur et régisseur de
plateau tout en fréquentant
l’EADS en tant qu’élève
libre. Cet intéressant épisode est interrompu par
le
service militaire qu’il effectue de 1950 à 1952
dans les casernes de Belfort,
Auxerre et Nevers, avant d’être appelé
à des tâches monotones dans les bureaux
de la cartographie de la Défense Nationale.
Libéré des obligations
militaires, il retrouve un temps, en
1953, le «Barabli»; il tient les mêmes
fonctions au «Théâtre
Central». A la
demande d’un architecte local il réalise des
décorations dans des écoles
d’Alsace et, à l’instigation du ministre
de l’Education Nationale, en Bretagne
et en Normandie. A cette occasion, il invente une technique de ciment
coloré
dans la masse où toutes les nuances peuvent
s’affirmer.
L’événement marquant
de 1953 est sa première exposition
personnelle à la Maison d’Art Alsacienne
à Strasbourg et Roger Mühl a la
satisfaction de voir le MAMCS acquérir deux de ses gouaches.
En 1954-55, il est
à Paris où il réalise la
décoration murale d’écoles. Il en
profite pour visiter
assidument les musées, attiré par les
éminents modernes que sont, à divers
titres, Delacroix, Van Gogh, Manet, Picasso, Braque, Villon…
En 1956, son destin se détermine: il se
marie avec
Jacqueline Friez, affectueusement appelée
«Line», la fille du
vétérinaire de
Montreux-Château, dans le Territoire de Belfort,
où il vivra une quinzaine
d’années. Elle deviendra sa muse. Cet
événement heureux donne un nouvel élan
à
sa peinture, il en hâte le développement.  Collection
particulière Collection
particulièreLine Huile
sur toile (1970), 150 x 160 cm
A partir de 1955, il s’engage dans une
nouvelle phase de sa
vie: celle des voyages à l’étranger,
«c’est
ma femme qui me pousse», avoue-t-il, qui le
mèneront en Hollande, en
Allemagne, dans les pays scandinaves, en Espagne et surtout en Italie
où il se
rend plusieurs fois, attiré par l’art des
Quattrocento et Cinquecento. Mais
c’est Florence qui l’enchante, ses monuments, son
Musée des Offices…  Collection
particulière Collection
particulièreVenise Huile sur toile, 100x81 cm (1961-70)
Les années 1955 – 58 vont leur
petit bonhomme de chemin,
avec, cependant, une exposition personnelle à Fribourg et
plusieurs commandes
de décorations. Roger Mühl travaille beaucoup pour
le 1% artistique que doit
comporter tout projet d’édifice public,
à Mulhouse, à Ittenheim, au temple
d’Ostheim, à la mairie de Mittelwihr, au temple
d’Illhausern…. Il décore des
Boeings, crée des vitraux, travaille à Aubusson
pour produire des tapisseries…
L’architecte et le pasteur
d’Ostheim confient à Roger Mühl,
en 1956, l’aménagement du chœur.
«On me
demandait, rapporte-t-il, d’y
insérer
les éléments matérialisant en quelque
sorte la rencontre de Dieu avec les
hommes: fonts baptismaux, autel, chaire. C’était
à la fois facile de suivre la
voie tracée, et très difficile: ainsi le grand
mur du fond en pierre de
taille brute, si imposant, monumental, risquait
d’écraser une forme trop
classique. […] Dans cet ensemble, pas de croix de bois ou de
fer forgé, trop grêles.
Seule une croix de pierre, au Christ gravé, pouvait marquer
l’unité profonde
entre les trois éléments…
[…] Sur le pignon Nord, un grand Christ en fer
forgé
étend ses bras bénissants…»
Ce précieux témoignage de
l’artiste prouve son sens affiné
de l’esthétique et sa conscience aigüe de
la mission qui lui était confiée.  Collection
particulière Collection
particulièreChrist gravé  Collection
particulière Collection
particulière
Christ
en fer forgé du temple d’Ostheim
1959 est à marquer d’une pierre
blanche. C’est la rencontre
d’un marchand de tableaux parisien qui va lui ouvrir toutes
grandes et d’emblée
les portes de la renommée. En visite chez le docteur Friez,
beau-père de Roger,
collectionneur de tableaux, il tombe en arrêt devant une
petite gouache signée
Mühl. Le tableau lui plaît, mais il dit ne pas
connaître le nom de l’artiste. «Il
s’agit
de mon gendre», lui apprend le docteur Friez qui
l’invite, séance tenante à
visiter l’atelier de Montreux-Château. Il est
enchanté des toiles qu’on lui
montre et touché par la modestie de la réponse de
Roger à la question:
- Avez-vous
déjà exposé?
- Oh,
très peu, une fois à Strasbourg et une fois
en groupe à Fribourg, mais ça n’a pas
donné grand-chose. Je n’ai pas assez muri
mon travail.» Il
emporte des toiles pour les exposer chez lui. Et, très vite,
«un lien étroit de
sympathie et de confiance mutuelle
s’établit entre les
deux hommes.» (1)  Collection
particulière Collection
particulièreDocteur
FRIEZ, Papy Huile
sur toile (1960-73)
Une exposition particulière est
organisée à la «Galerie de
Paris», le 6 juin 1960. C’est un succès
éclatant qui
dépasse toutes les espérances. D’autres
expositions se succèdent à Paris, puis
à New-York qui répondent pleinement aux
attentes de l’artiste. Sa renommée naissante prend
de l’ampleur. L’Etat lui
achète, en 1960, la toile intitulée
«L’Atelier». Il est
sélectionné à la
célèbre Galerie Charpentier pour figurer parmi
les peintres de «l’Ecole de
Paris» qui brille de ses derniers feux et qui
était censée faire de Paris un
centre d’art de premier plan. Puis, il est
sélectionné à la Galerie
Saint-Placide,
pour le Prix de la Critique. En 1961, il obtient le prix
«Prestige des Arts»
Avec Mühl, la province prend sa revanche
sur la capitale.
Qu’un peintre, retiré dans sa contrée,
capte l’attention d’un marchand de
tableaux parisien de renom et soit suivi par la critique, les amateurs
d’art et
un large public de connaisseurs est un phénomène
rare dans un marché de l’art
très figé et prouve de façon
irréfutable le talent exceptionnel de Roger Mühl.
C’est à cette époque
qu’il s’adonne à la lithographie. A
l’occasion de son exposition à Paris, il
découvre l’atelier de Fernand Mourlot,
maître imprimeur-lithographe, Installé rue
Barrault dans les années 1960, puis
rue du Montparnasse en 1976, qui a accueilli Matisse, Braque, Bonnard,
Miro et
qui est l’imprimeur attitré de Chagall et de
Picasso. C’est au contact de ces
grands maîtres qu’il se familiarise avec cette
technique qui le passionne et
qu’il a, depuis, parfaitement assimilée.
L’oeuvre lithographié de Mühl occupe
une place prépondérante dans l’histoire
de l’estampe contemporaine, souligne
Charles Sorlier, graveur, qui exerça
son
art à l’atelier Fernand Mourlot à
partir de 1948, durant plus de quarante ans.
Charles Sorlier possède plusieurs
tableaux de Roger Mühl,
dont un grand paysage provençal. «Lorsque
l’agitation de la vie quotidienne me déprime par
trop, a-t-il écrit en
1986, je me sers un pastis bien frais,
m’installe confortablement devant cette toile et
j’entends aussitôt la
stridulation des cigales…
A ta santé, Roger…»
Comme Roger Mühl se rendait
régulièrement chez Mourlot, il
a acquis un appartement à Montparnasse. Roger aimait Paris.
Il a consacré
plusieurs tableaux à ses quartiers emblématiques.  Collection
particulière Collection
particulièreRue
de Paris, le matin Huile
sur toile
La lithographie le conduit à
réaliser une œuvre intimiste à
travers l’illustration de livres, notamment
«L’Aventure occidentale de
l’Homme»
de Denis de Rougemont, dans le cadre du Prix littéraire
organisé chaque année
de 1965 à 1975 environ, par le Prince de Monaco.
L’exemple, ci-dessous, est
dédié à Guy Bardone, son ami peintre
de Saint-Claude.  Collection
particulière Collection
particulièreLes
Vosges,
1973 Pastel
gras
Il a illustré des
œuvres de Marcel Pagnol (1978),
d’Albert Camus, la même année, ainsi que
des livres de recettes des grands
chefs français: Bocuse, Chapel, Troisgros, Vergé,
Haeberlin, tous devenus ses
amis fidèles, tous ayant leur portrait dans la cuisine
d’hiver de la maison de
Mougins.  Collection
particulière Collection
particulière
En effet, en 1965, il gagne la lumière de
la Côte d’Azur,
s’installant d’abord à Grasse, de 1965
à 1975, dans une vieille bergerie, et
ensuite à Mougins dans le bâtiment cossu et
élégant de l’ancienne poste, datant
du 18ème siècle,
qu’il aménage avec un goût
raffiné et dont il conserve
soigneusement la boîte aux lettres de Picasso qui
emménagea, en juin 1961 à
Notre-Dame de Vie, une villa provençale isolée
sur une colline de Mougins et
qui y mourut le 8 avril 1973.  Collection
particulière Collection
particulièreCampagne
de Grasse Huile sur toile, 160 x 150 cm (1971-80)  Collection
particulière Collection
particulièreRoger
MÜHL à Mougins
Il y coulera des jours heureux entre Line et leurs
deux
fils, Patrice et Richard. Patrice, diplômé de
L’Ecole du Louvre deviendra
expert en œuvres d’art des XIXème et
XXème siècles et se consacrera à
promouvoir l’œuvre de Roger Mühl et
à perpétuer sa renommée. Richard
connaîtra
un sort tragique; participant en tant que photographe de Paris-Match,
à
l’expédition «Africa Raft» de
Philippe de Dieuleveult, il meurt assassiné sur
le fleuve Zaïre, le 6 août 1985.  Collection
particulière Collection
particulièreRoger
Mühl entouré de ses fils, Patrice et Richard  Collection
particulière Collection
particulièreJardin
à Mougins Aquarelle
(vers 1992)
A Mougins, Roger Mühl aime
«voyager» dans son jardin. Il en
témoigne avec plaisir dans le message qu’il
adresse en 1987, à ses hôtes lors
de son exposition au Japon, à l’Art Center Hall de
Tokyo, émerveillé par
l’amour et le respect de la nature qui caractérise
le peuple japonais: «A Mougins,
chaque matin, avant de monter
à l’atelier, je consacre plusieurs heures
à mon jardin. Je l’entretiens moi-même
et y puise une nourriture sans cesse
renouvelée au rythme des saisons.
Dans le midi de la France, poursuit-il, les jardins sont au printemps
qu’immenses
bouquets de fleurs blancs, roses, bleus, ponctués par le
feuillage argenté des
oliviers et plus sombre des orangers.
L’été,
l’arrière-pays est blanc,
écrasé
de soleil, et la mer, d’un bleu profond, se confond avec le
ciel. Puis vient
l’automne et sa lumière
dorée…» (3) «Les thèmes de la nature sont nombreux et essentiels, affirme Roger Mühl. Je me souviens qu’un jour, je peignais la campagne provençale pour la première fois. Mais, j’étais tellement intoxiqué par les Vosges que je croyais avoir peint le Ballon d’Alsace et non l’Esterel». C’est dire combien le pays natal est resté présent dans son cœur. En témoignent ces paysages qu’il a interprétés selon sa propre vision des choses.  Collection
particulière Collection
particulièreLes
Vosges Huile
sur toile (100 x 50 cm)  Collection
particulière Collection
particulièreVillage Huile
sur toile, 46 x 38 cm (1950-60)
Cet amour de la nature que Roger Mühl
ressent au plus
profond de lui-même, remonte à son enfance
bucolique. Son maître de l’EADS,
Léon Lehmann, l’a assurément
amplifiée, l’emmenant souvent dans les jardins de
l’Ecole. «Il le faisait
dessiner sur
place des arbustes et des plantes sauvages en insistant sur
l’élégance des
formes, le rythme intérieur, afin que
l’élève saisisse mieux leur fonction.»
(1)
Tout
en lui laissant sa liberté d’expression, Lehmann
lui apprend les arcanes du
dessin. C’est par le dessin qu’il étudie
les métamorphoses de la nature, par
lui qu’il l’interprète et la reproduit
à la lettre comme en témoignent les
nombreuses études de plantes et d’herbes sauvages
agrandies sur format grand
aigle, lui donnant ainsi la possibilité de «saisir
l’élément vital qui préside
au rythme de croissance. Ces travaux lui font découvrir
des formes nouvelles et
inattendues.» (1)  Collection
particulière Collection
particulièreCroquis
préparatoire Crayon  Collection
particulière Collection
particulièreAmandier Huile
sur toile, 120 x 130 (2007)  Collection
particulière Collection
particulièreOliviers Huile
sur toile, 160 x 150 (1981-88)  Collection
particulière Collection
particulièrePin
maritime Huile
sur toile, 110 x 120 (expo 2007)
Roger Mühl n’est pas
qu’un œil. Sa peinture figurative est
remarquable, justement, par son attention aux rythme profonds de la
nature «Il les exprime en temps
forts et faibles,
touches vives et sourdes, traçant ainsi ce qui existe et ce
qui se métamorphose sans
cesse, invisible à nos
yeux, si évident aux siens.» (4)
Sa
vision se teinte d’imagination sans abandonner le
réel
au profit d’un mythe. Ainsi, les images qu’elle
enrichit ne
frisent que
rarement l’abstraction; si ce n’est, entre autre,
par un
rapprochement, peut-être
fortuit, avec Nicolas de Staël, le peintre le plus en vue dans
les
années 1950,
dans des «compositions» en gris et bleu,
d’une
organisation subtile et statique
à l’intérieur d’une palette
réduite,
obéissant à la règle stricte des
valeurs.  Collection
particulière Collection
particulièreAntibes Huile
sur toile, 162 x 130 (1971-80)  Collection
particulière Collection
particulièrePort
de Strasbourg Encre
de Chine, craie grasse et aquarelle, 1957  Collection
particulière Collection
particulièreNew-York Huile
sur toile (1961-70)
Dans son évolution, Roger Mühl
va vers des formes plus
libres, plus généreuses. Ses tableaux se
caractérisent par une grande
simplification. Sa peinture reste figurative, mais moderne. Michel
Bohbot, dans
le catalogue de l’expo de Findlay, écrit: «Il
traque et découvre dans chaque composition le lieu de
genèse…et nous y
conduit…Son œil écarte le pittoresque
au profit de l’essentiel. Une vision en
abrégé sur une recherche des courants, soucieux
de rendre les puissances nées
de la rencontre du sujet et de la sensibilité de
l’artiste.» La
simplification des masses met en exergue
les lignes d’architecture à partir desquelles ne
subsistent que liberté d’esprit
et pureté des lumières, constate
Gérard Blaise.  Collection
particulière Collection
particulièreMaisons
à Antibes Huile
sur toile, 110 x 120 (2007)  Collection
particulière Collection
particulièrePrintemps,
vallée du Rhone Huile
sur toile, 114 x 146 (2007)  Collection
particulière Collection
particulièreLac
de Saint-Cassien Huile
sur toile
Christine Gleiny, dans sa précieuse
étude de 1963, souligne «Qu’alors
que l’expression de la couleur
était recherchée par l’adjonction
d’un contour sombre, l’emprisonnant pour la
mettre en valeur suivant le principe du clair-obscur,
l’entreprise, dès lors,
consiste à trouver dans les vertus intrinsèques
de la couleur, et en elles
seules, le moyen d’en exalter
l’éloquence».
Les
confidences du
peintre nous guident à ce propos:
«Je
pense que chaque sujet a sa couleur propre. L’essentiel est
de la dégager. Le
plus important est son mûrissement. Il ne s’agit
pas de faire vivre une
couleur avec une
complémentaire ou une
opposée, mais, par des couches superposées qui
lui donnent sa respiration
intérieure, elle doit se suffire et vivre en
elle-même.»  Collection
particulière Collection
particulièreFleurs
rouges Huile
sur toile (1960-70)  Collection
particulière Collection
particulièreCalanques Huile
sur toile, 160 x 150 (1981-88)  Collection
particulière Collection
particulièreAutomne Huile
sur toile 150 x 160
Grâce à cette savante
élaboration de la couleur, «célébration
saisissante par lavis successifs
qui organisent, caressent,
accentuent, touchent au plus» (5),
ses
tableaux se distinguent par un coloris d’une exceptionnelle
douceur, toujours
harmonieuse. Roger Mühl est un «dégustateur
de couleurs, un œil gourmet», se plait
à dire Guillevic en 1992, à propos
des «Aquarelles d’un
été». Il est aussi et
peut-être surtout, selon le même
critique, «un peintre requis par la
lumière», l’ayant suivi dans
une saison à la fois bretonne et provençale,
chantant les vagues d’Ouessant et les pins de Mougins,
«sur un fond de lumière
exaucée».  Collection
particulière Collection
particulièreLumière
du matin, Bretagne Huile
sur toile, 114 x 146 (2007)  Collection
particulière Collection
particulièreHuile
sur toile, 80 x 85
Cette lumière éclatante de
pureté qui est le principal
mérite de Roger Mühl, semble l’habiter.
Il en résulte «de
véritables symphonies en blanc qui, de par la
difficulté de la
tâche entreprise, donnent la pleine mesure de son immense
talent.» (1)  Collection
particulière Collection
particulièreIntérieur
blanc Huile
sur toile, 80 x 85  Collection
particulière Collection
particulièreRochers Huile
sur toile, 120 x 130  Ill IllHuile
sur toile
A l’origine de ces admirables taches
colorées de lumière,
il y a cette pâte qu’il élabore avec
attention et délicatesse et qu’il sait
rendre mystérieusement lumineuse. C’est,
concrètement, d’une impressionnante
palette en forme de double cratère que naît sa
peinture en «fusion», l’un,
immaculé, l’autre, fourmillant de mille nuances
agglomérées.  Collection
particulière Collection
particulièreRoger
MÜHL dans son atelier  Collection
particulière Collection
particulièreLa
palette  Collection
particulière Collection
particulièreLe
chevalet Lithographie
Avant de peindre une toile, il établit
une ligne directrice.
Il ne peint que rarement directement sur le motif sans
préparation stricte se
rappelle son ami Jean-Pierre Haeberlin. «Il
fait des croquis, en rapporte l’idée,
a-t-il expliqué à Christine Gleiny, et cela même pour le portrait. La toile
terminée, il la compare au modèle.
Après s’être
imprégné du grand concert de la
nature, il la recompose en y faisant
passer ses émotions, ses sensations de
sorte que le réel, transcendant
d’emblée la reproduction trop monnayée,
rejoint l’imaginaire pour de merveilleux
éblouissements. Le subconscient apporte son concours
à ces équivalences
plastiques du réel décanté, mais au
lieu de stimuler le lyrisme, il agit,
contrairement à son habitude, comme
élément modérateur» (1)  Collection
particulière Collection
particulièrePortrait Huile
sur toile
Car Roger Mühl ne refuse pas
l’ordre vital du monde. Il
s’en imprègne dans la plus «libre
respiration, la plus agissante ouverture sensorielle dont il soit
capable»
(5)
Sa
conception de l’art exige qu’il s’efface
pour être présent à
l’intérieur de
soi, qu’il renonce dans sa quête d’une
impeccable limpidité à toute
«coruscance»,
à toute «boulimie».  Collection
particulière Collection
particulièreJardin
printanier, mimosas Huile
sur toile  Collection
particulière Collection
particulièreLa
Saône à Collonges-au-Mont d’Or Huile
sur toile, 97 x 162 cm (2007)
Par
le dialogue entre le réel et lui, il affirme son
«moi».
Dans sa peinture qui subit un dépouillement rigoureux, une
«décantation
raisonnée», se reflète son
état
d’esprit. «Homme d’un calme
marmoréen»,
il a
su, malgré le succès, garder sa
simplicité, un
solide bon sens garant d’un égo
conciliant. Ce que confirme son portrait physique que nous devons
à Christine
Gleiny: «En voyant Roger
Mühl on sourit à
la pensée de certains traits, véritables poncifs
caricaturaux dont on aime à
affubler les artistes. Notre peintre n’a pas le cheveu en
désordre, l’œil
hagard et le propos
inintelligible.
Grand et solide gaillard, aux gestes sobres, au visage
réfléchi, il respire
l’équilibre et a soin de sa personne.»  Collection
particulière Collection
particulièreRoger
MÜHL préparant l’exposition de Tokyo de
1987
Roger Mühl réalise
principalement des peintures à l’huile
tout en faisant plusieurs expositions d’aquarelles. «A ses débuts, il utilise
également la gouache. Il fait des dessins à
la plume et à la mine de plomb, ainsi que des lavis, des
lithographies et des
gravures à la mine de plomb, des décorations
murales, […] des vitraux et des
illustrations de livres.» (4)  Collection
particulière Collection
particulièreVillage
en Alsace Lithographie,
lavis d’encre de Chine, 1956
L’ensemble de son œuvre comporte
essentiellement des
paysages, des natures mortes et des portraits. Elle est
variée et originale
dans la mesure où il procède par
thèmes. C’est, d’ailleurs, selon ce
critère
qu’il classe, dans son atelier, ses dizaines de toiles,
ébauches et esquisses, «par
exemple la forêt, la rivière, les
Alpilles, les vieux villages, les
maisons, la Bretagne, la piscine avec des nus» (4)
et
plus singulièrement la gastronomie qui l’amena
à brosser les portraits des
chefs célèbres et à peindre des
tableaux consacrés aux cerises, aux
champignons, aux citrons, aux radis, à l’assiette
aux asperges, aux pommes
vertes…  Collection
particulière Collection
particulièreLes
Alpilles Huile
sur toile  Collection
particulière Collection
particulièreNu Huile
sur toile, 38 x 40 cm (1971-80)  Collection
particulière Collection
particulièreNu devant la fenêtre Aquarelle (1992)  Collection
particulière Collection
particulièrePaul
Haeberlin en cuisine Huile
sur toile ,220 x 130 cm (1981) ornant l’Auberge de
l’Ill  Collection
particulière Collection
particulièreChou Huile
sur toile, 40 x 38 cm (1971-80)  Collection
particulière Collection
particulièreHuitres Huile
sur toile, 32 x 30 cm
Toutes les galeries du monde l’ont
accueilli. «Il a exposé
à la Galerie de Paris, chez
Lucile Manguin, la fille du célèbre peintre
postimpressionniste, puis dans de
nombreuses autres galeries telles que la Galerie Pacitti-Schmit,
Faubourg
Saint-Honoré; ensuite à New-York, Tokyo (en 1987,
1990, 1992) et chez Grossmann
à Schaffhouse en Suisse, sans
oublier
chez son vieil ami Pierre Marchand à
Belfort…», nous rappelle Jean-Pierre
Haeberlin.
En 1988, Strasbourg et Colmar envisagent
d’offrir à Roger
Mühl une exposition rétrospective. Mais ce fut la
galerie du vieux Belfort
qu’il choisit par amitié. 110 œuvres
furent exposées dans l’emblématique
«Tour
41». A cette occasion, une lithographie sur le Vieux Belfort
a été éditée
spécialement et Roger Mühl a offert au
musée de la ville un portrait de Zadkine
dans son atelier. Notons que Raymond Forni, président de
l’Assemblée nationale,
puis président du Conseil Régional de
Franche-Comté lui passe une commande. «On
m’avait bien recommandé de peindre un
paysage coloré et surtout sans nuages. La toile est bien
accrochée, aujourd’hui
au Palais Bourbon», précise
l’artiste.  Collection
particulière Collection
particulièreIl
participe à un certain nombre d’expositions de
groupes
à
l’Ecole de Paris, Galerie Charpentier à Paris, en
1962,
à la Galerie d’Art
alsacienne à Mulhouse, la même année,
il revient
à la Galerie Charpentier en
1964, à l’exposition Grands et Jeunes
d’Aujourd’hui, à Paris, la
même année,
à
Tokyo-Kyoto-Osaka au Japon en 1968, au salon des Peintres
témoins de leur Temps
à Paris, au Musée de Strasbourg, à
Vision Nouvelle
Paris, Lithographies, en
1972, … La
profonde connaissance de l’Histoire de l’Art,
acquise
dans sa jeunesse, médiation nécessaire
à la perception du beau, a développé
en
Roger Mühl le sens esthétique qui n’est
pas forcément inné, mais l’objet
d’une
formation progressive. Néanmoins,
ce qui rend son œuvre particulièrement
attachante et lui confère son caractère propre,
ce ne sont pas uniquement les
tendances dont il s’inspire, ni les
références envers lesquelles il est
respectueux, «mais
l’expression qui jaillit
toujours plus serrée, toujours
plus
intense des sensibilités qui le remuent»
(1) et qui font qu’il a toujours
su rester lui-même. «Peintre de la
lumière douce, poète autant que bon vivant, il
nous convie aux noces de
l’intelligence et du cœur. Ce qu’il vise,
c’est le don, l’offrande d’un bonheur
simple et pur. Car ce lyrique est aussi un
épicurien…» Hommage
de M. Michel FRANCA, critique d’art «Tous deux reposent en paix au pied de leur propriété qu’ils ont tant aimée et que Roger a su peindre et croquer sous tous les aspects.» (6) Annexe 
Bibliographie
-
Christine Gleiny (1) – Mühl
– Ed. Fernand Mourlot, 1963
- Madeleine Haeberlin (2) – Hommage à Roger Mühl – Manuscrit - Roger Mühl (3) – Message – à Monsieur Kajikawa, Japon -
Me
Lotz (4)
– Artistes alsaciens de jadis et
naguère – Printek Kaysersberg -
Guillevic
(5)
– Un peintre requis par la
lumière – 1992 -
Philippe
Girard – Saveurs
lumineuses de Roger Mühl – -
Gérard
Blaise – Jardin à Mougins
– - Jean-Pierre Haeberlin (6) – Hommage à Roger Mühl
|